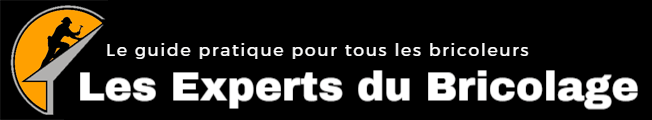Considérée comme un animal nuisible, la martre peut être piégée et capturée dans plusieurs départements français. En effet, hormis la Charente et l’Isère, ce mammifère carnivore peut être apprivoisé grâce aux pièges à martre dans les conditions prévues par la loi. Comment piéger une martre ? Éléments de réponse !
Bien connaître la martre pour la capturer
Petit mammifère de la famille des mustélidés, la martre est un omnivore. Mais, elle affectionne particulièrement les proies vivantes comme les petits rongeurs et les batraciens.
Elle mesure environ 80 cm de long à l’âge adulte quand on inclut sa longue queue pour un poids de 1,5 kg. Avec sa petite tête, elle est dotée de pattes très courtes lui permettant d’atteindre à peine les 25 cm de hauteur. Son museau est pointu et sa fourrure épaisse. Contrairement aux différences remarquables entre le lynx canadien et le lynx roux, la martre n’est pas facile à identifier sauf grâce à son pelage. La particularité de celui-ci est qu’il est de couleur brune foncée excepté au niveau du ventre et de la partie inférieure de son cou où il est jaunâtre.
Identifier les traces de la martre pour bien placer votre piège
La martre n’est pas un animal simple à repérer. En effet, elle est essentiellement nocturne. Toutefois, il y a de nombreuses traces qui permettent de repérer le passage d’une martre chez vous. Parmi celles-ci, il y a les traces de ses griffes. En effet, la martre ne peut s’empêcher de rayer et d’égratigner les arbres et autres supports sur lesquels elle se pose. C’est également le cas des câbles électriques qu’elle ronge. Aussi, les restes d’animaux comme les cadavres d’oiseau, de souris ou d’autres petits rongeurs sont autant de signes montrant que vous avez reçu la visite d’une martre.
En plus de ses différentes traces, il y a son odeur. Comme les chats, elle marque son territoire et laisse des déjections nauséabondes dans lesquelles sont visibles les débris de son alimentation. Ainsi, comme pour identifier les déjections des coyotes vous pouvez clairement repérer des noyaux de cerises ou ceux d’autres fruits sauvages qu’elle affectionne dans ces crottes.
Trouver le bon piège pour capturer la martre
Pour piéger une martre, vous devez utiliser un piège qui répond aux normes. Celui-ci doit être soit une marque et un modèle certifié ou approuvé.
Ceux-ci sont généralement des cages métalliques permettant de capturer l’animal sans lui causer des dommages physiques. L’avantage de ces pièges à martre que vous pouvez acheter dans le commerce est qu’ils se referment sur l’animal une fois que celui-ci est à l’intérieur. En plus des cages métalliques, il y a des pièges à œufs que vous pouvez placer sur votre propriété. Ils se déclenchent aussitôt que l’animal saisit l’œuf.
Enfin, si vous êtes dans un département où la chasse des martres est permise, vous pouvez les capturer dans leur habitat naturel en utilisant des appâts et des pièges adaptés. L’un de ceux-ci est celui des tubes de papier journal. Également vendus dans le commerce, ils se suspendent verticalement à un arbre à hauteur de poitrine ou horizontalement à une chute morte. L’appât est placé à l’arrière de la boîte, avec un piège à l’avant. La martre grimpe dans l’arbre et traverse le piège pour atteindre l’appât et se fait prendre dans le piège de façon irrémédiable. C’est aussi une excellente manière de piéger une martre.
Mesures complémentaires : prévention, suivi et relocalisation
Au-delà de la capture, il est essentiel d’adopter une stratégie globale axée sur la réduction des attractifs et le respect du bien-être animal. Des mesures d’exclusion peuvent limiter les intrusions : calfeutrer les accès aux combles, poser des grilles sur les ouvertures de grange, installer des filets autour des volières ou organiser un stockage hermétique des denrées et des déchets qui attirent la faune. L’observation comportementale, via de la surveillance vidéo ou des relevés nocturnes, permet d’identifier les itinéraires de passage, les points de repos et les habitudes alimentaires sans multiplier les captures. Ces éléments relèvent de l’éthologie appliquée et aident à mettre en place des corridors ou des barrières adaptés à la zone concernée, en tenant compte de la niche écologique de l’animal et de la dynamique des populations locales.
Lorsque la capture devient nécessaire, privilégiez des protocoles de manutention et de relocalisation encadrés : examen sanitaire, tenue d’un registre des interventions et remise en liberté uniquement vers des secteurs compatibles en termes de ressources et d’autorisation administrative. Le piégeage doit s’accompagner d’actions préventives sur l’habitat pour réduire le risque de retour et préserver la biodiversité environnante. Pour des conseils pratiques, des modèles de fiches de suivi et des recommandations sur les pratiques non létales et la conformité réglementaire, consultez le site La Maison Montigny, qui compile des ressources sur la gestion et la cohabitation avec la faune sauvage.
Approches complémentaires : répulsion, santé et suivi participatif
Outre les captures encadrées, il existe des leviers non létaux pour limiter les incursions : l’utilisation de répulsifs olfactifs et dispositifs ultrasoniques, l’installation de barrières physiques complémentaires et la gestion ciblée des sources alimentaires. Ces méthodes demandent une évaluation préalable car l’efficacité est variable et l’animal peut s’y habituer ; de plus, certains dispositifs peuvent perturber d’autres espèces ou échouer en milieu ouvert. Sur le plan sanitaire, il est important d’intégrer la prévention des maladies zoonotiques et des parasites externes lors des opérations : toute manipulation doit réduire le risque de transmission, limiter le stress physiologique de l’animal et prévoir un contrôle vétérinaire si nécessaire. Évitez l’emploi d’appâts toxiques ou de produits non autorisés, qui présentent un danger pour la faune non ciblée et la santé publique.
Pour une gestion durable, complétez les dispositifs par un suivi scientifique et citoyen : relevés photo, marquage photo-identification, analyses d’ADNe sur points d’eau ou fèces, et fiches de signalement en science participative permettent de mieux cartographier la présence et la dynamique locale. Un retour d’information coordonné entre riverains et services techniques favorise des actions adaptées (aménagement des abords, suppression d’abris artificiels, gestion différenciée des lisières) tout en préservant la connectivité écologique. Adoptez une stratégie adaptive : tester, évaluer, ajuster.
Protocoles post-capture et suivi technologique
Après la capture, il est primordial d’appliquer des procédures strictes pour limiter les risques sanitaires et garantir une remise en liberté réussie. Instaurer une quarantaine courte mais contrôlée permet d’observer l’animal et de pratiquer des examens rapides (contrôle des parasites externes, prélèvements pour analyses biologiques). Coupler ces contrôles à des opérations de désinfection ciblée du matériel et des cages réduit la transmission d’agents pathogènes entre individus et sites. Le choix d’un matériel de contention adapté et d’équipements de protection individuelle pour les intervenants limite le stress physiologique de la martre et préserve la sécurité des manipulations. Documenter chaque intervention avec un registre standardisé (date, lieu, état sanitaire, interventions réalisées) favorise la traçabilité et la constitution d’un référentiel local utile aux études épidémiologiques et à l’amélioration des pratiques.
Pour valider l’intégration de l’animal relâché, privilégiez des dispositifs de suivi non intrusifs : la géolocalisation par balises temporaires ou le recours à des capteurs de présence (caméras à détection et capteurs de mouvement) permettent d’évaluer l’utilisation du territoire et la réoccupation du microhabitat choisi. Ces données facilitent l’élaboration d’un plan de gestion adaptatif : tester une action, mesurer les effets, ajuster les aménagements (couvert végétal, abris naturels) et réduire les épisodes de récidive. Enfin, la formation des intervenants et la coordination avec les acteurs locaux renforcent la qualité opérationnelle des relâchers et diminuent les risques d’échec.
Aménagement écologique et mobilisation locale pour prévenir les conflits
Au-delà des interventions directes sur l’animal, agir sur le paysage et les ressources disponibles réduit fortement les interactions indésirables. En favorisant une mosaïque paysagère équilibrée (alternance de haies, bosquets, lisières et clairières) on module la distribution des proies et on diminue les points d’attraction concentrés autour des habitations. Quelques mesures simples et complémentaires peuvent être mises en œuvre : diminuer les gîtes pour petits rongeurs (tas de bois, amas de débris), limiter les stocks alimentaires accessibles, et ajuster la stratification végétale près des bâtiments pour réduire les corridors de progression verticale. La restauration d’éléments structurels naturels (couvert arboré discontinu, tapis de litière naturel) favorise des biotopes plus résilients et limite la formation de réservoirs de faune commensale, tout en aidant la gestion des métapopulations locales et en réduisant la probabilité de recolonisation rapide.
La coordination entre voisins et acteurs locaux renforce ces actions : cartographier les observations, harmoniser les pratiques de stockage des déchets et planifier des interventions paysagères collectives permet d’augmenter l’efficacité des mesures préventives. Des outils de concertation (réunions de quartier, fiches techniques partagées, protocoles d’entretien des haies) facilitent une approche de gestion intégrée fondée sur la prévention, la surveillance et l’adaptation.
Cadre administratif et bonnes pratiques saisonnières
Avant toute action, il est important de connaître le cadre légal et d’adapter le timing des interventions : la martre suit un cycle de reproduction marqué (période de rut, mise bas et phase de sevrage) et la capture d’une femelle en période de nidification ou près d’une nurserie peut entraîner l’abandon des petits et un fort impact démographique. Respecter les obligations administratives et temporelles signifie vérifier s’il existe des restrictions locales (arrêtés, périmètres protégés) et éviter toute intervention durant la saison où les portées sont présentes. En complément des aspects opérationnels, constituer un dossier de justification avec photos et relevés facilite les échanges avec les autorités compétentes et permet d’anticiper les contestations en cas de préjudice.
Sur le plan organisationnel, privilégiez une démarche formalisée : obtenir les autorisations nécessaires, s’assurer d’une assurance couvrant la responsabilité civile des intervenants, et travailler avec des personnes disposant d’une attestation de compétence ou d’une formation adaptée à la manipulation d’animaux sauvages. Établir des conventions simples avec les propriétaires fonciers et informer le voisinage réduit les risques juridiques et améliore la traçabilité des opérations (procédure de signalement, compte-rendu d’intervention, plan communal de gestion). Ces précautions minimisent le risque de sanctions et favorisent des sorties respectueuses du cycle biologique de l’espèce tout en protégeant les intervenants.